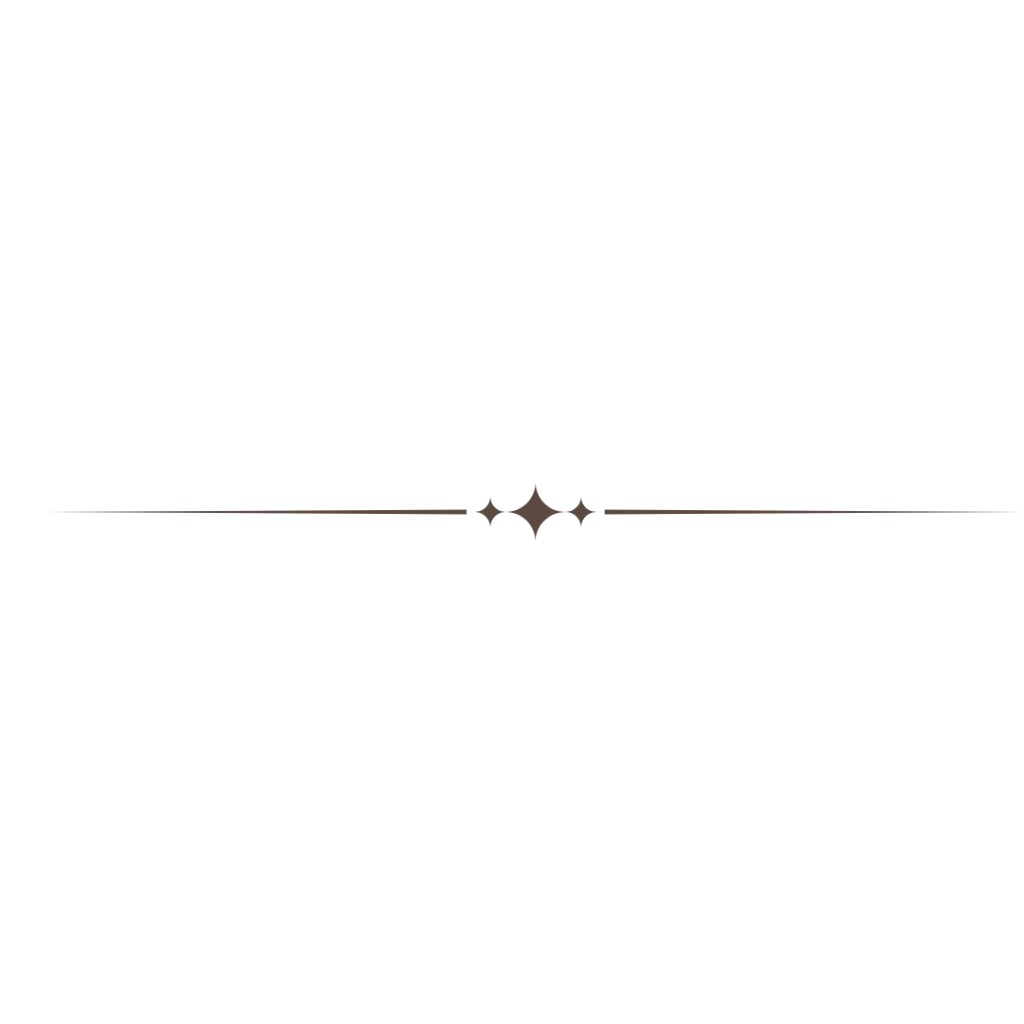debrief
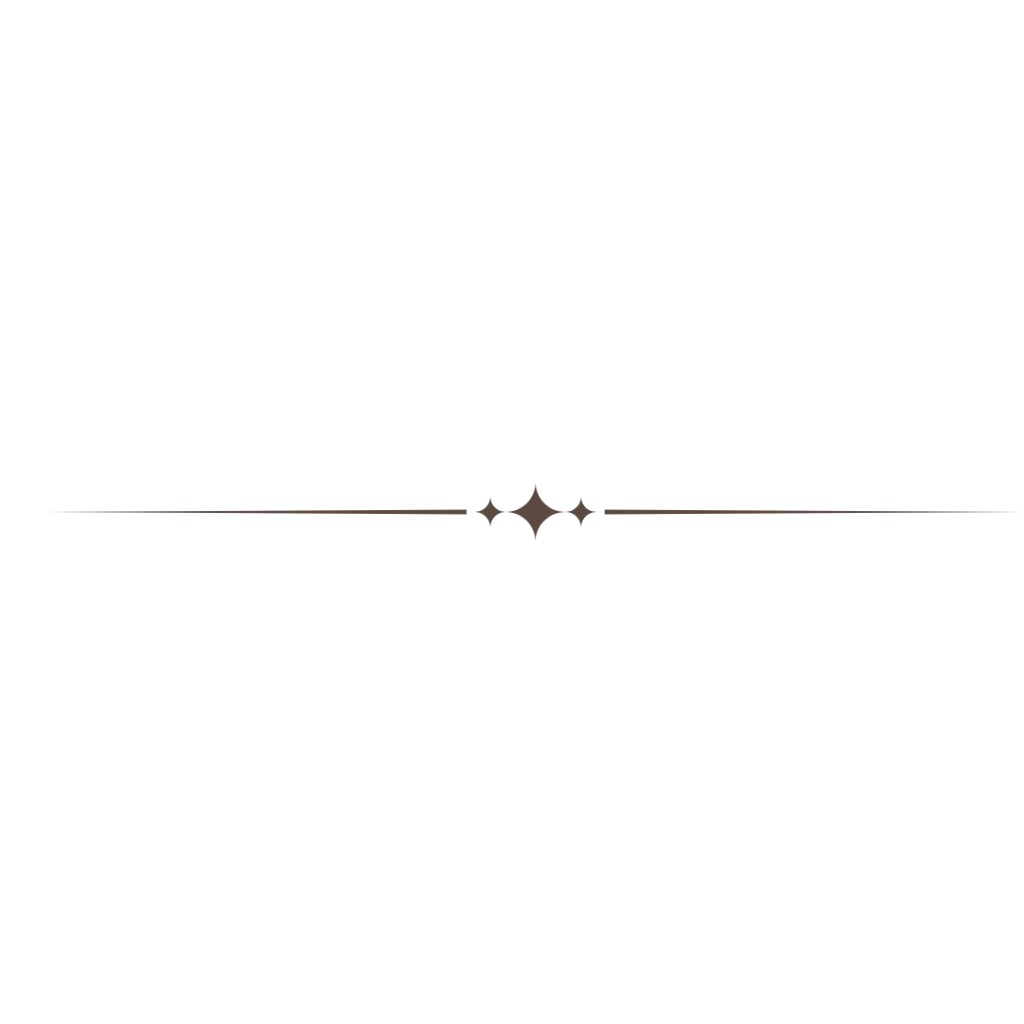
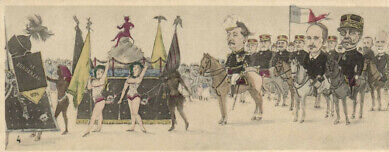
L’Affaire aura duré douze ans. Douze longues années qui auront révélé au grand jour plusieurs éléments majeurs.
Une France imprégnée d’antisémitisme et de xénophobie
L’Affaire Dreyfus met en évidence un pays profondément marqué par l’antisémitisme et la xénophobie, corollaires du nationalisme dominant. L’époque est à la dénonciation du « complot juif », un thème récurrent utilisé pour expliquer les dysfonctionnements de la société. Cet antisémitisme n’épargne aucune classe sociale : il touche autant la bourgeoisie et les élites que les milieux populaires. On ne peut s’empêcher de faire le parallèle avec la catastrophe qui frappera la France une quarantaine d’années plus tard sous le régime de Vichy et la Collaboration.Le nouveau rôle de la presse écrite
La presse s’affirme comme une force incontournable dans la société française. La loi de 1881 sur la liberté de la presse permet aux figures les plus virulentes, comme Édouard Drumont et Gaston Méry dans La Libre Parole, ou encore les pères assomptionnistes dans La Croix, de propager leurs idées.
La presse joue un rôle décisif dans la structuration de l’Affaire : c’est elle qui rythme les événements en diffusant et en orientant l’opinion publique. La Libre Parole de Drumont force le ministre de la Guerre à rendre l’affaire d’espionnage publique, tandis que L’Aurore relance l’Affaire grâce à la lettre ouverte de Zola. L’image et la caricature prennent une place essentielle dans le débat, illustrant les articles des journalistes et intellectuels, voire s’y substituant. À travers l’Affaire, se dessinent les contours de la presse moderne telle que nous la connaissons aujourd’hui.
- L’émergence des intellectuels dans la vie politique
L’Affaire Dreyfus marque l’entrée en scène des intellectuels dans le débat public. Écrivains, artistes, savants et universitaires s’engagent activement, que ce soit pour défendre Dreyfus ou pour le condamner. Ils signent des pétitions, publient des articles virulents et des lettres ouvertes, témoignent dans les procès et participent à des meetings. Ils prennent conscience de leur pouvoir et s’indignent, affirmant leur attachement aux valeurs de justice et de démocratie républicaine.
L’Affaire contribue à affaiblir les forces réactionnaires de la Nation et à renforcer la démocratie parlementaire, consacrant la suprématie du pouvoir législatif et judiciaire sur l’armée.
Enfin, l’Affaire a des répercussions internationales. Elle inspire le projet sioniste de Theodor Herzl, convaincu que les Juifs doivent avoir un État pour ne plus être persécutés. Ce mouvement aboutira, un demi-siècle plus tard, à la création de l’État d’Israël.